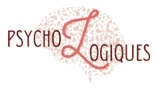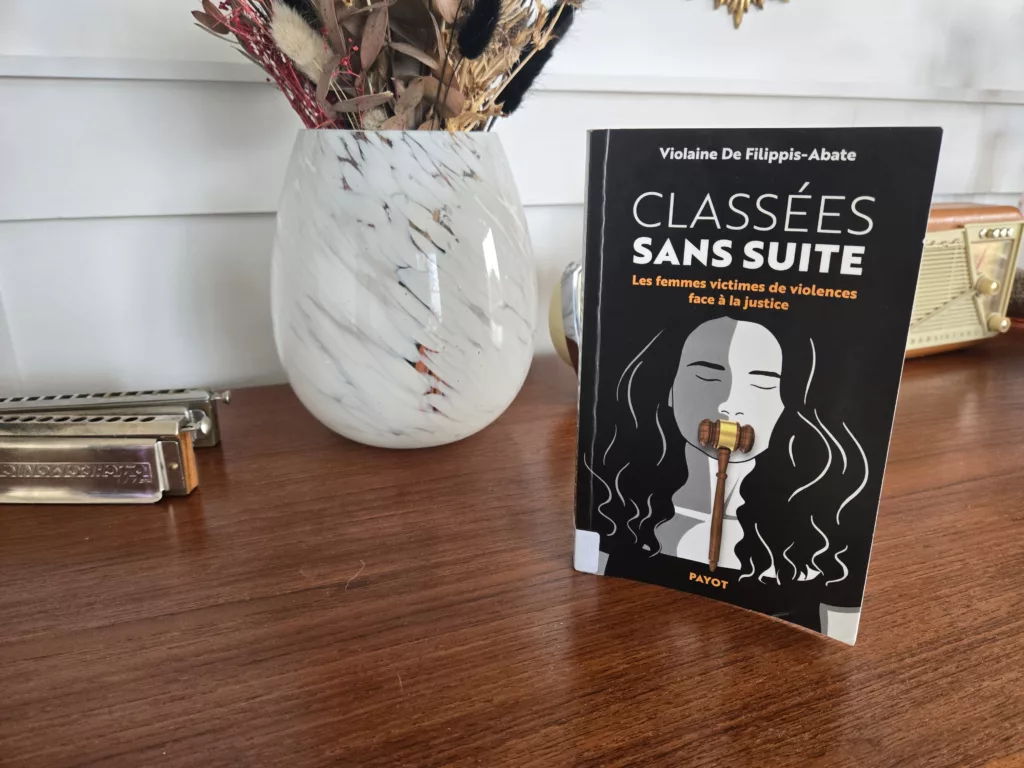
Le décalage entre les promesses du système et la réalité des classements sans suite
L’un des points centraux de Classées sans suite est le contraste saisissant entre ce que le système judiciaire est censé garantir et ce qui se passe en réalité. En théorie, chaque plainte déposée pour violences conjugales ou sexuelles devrait déclencher des investigations approfondies. Les auditions des parties, les enquêtes de voisinage, les analyses médico-légales, et les recherches sur les antécédents sont censées permettre aux procureurs de prendre des décisions éclairées.
En pratique, ces étapes essentielles sont souvent absentes. Le livre révèle que 80 % des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite. Ce chiffre ahurissant témoigne d’un manque criant de moyens, mais aussi d’une culture où les violences contre les femmes sont encore minimisées.
Des témoignages poignants illustrent ce dysfonctionnement : une femme ayant déposé plainte pour des violences graves raconte : « Je n’ai jamais été recontactée. On m’a dit qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour poursuivre, mais ils n’ont même pas interrogé mon agresseur. » Ces récits rappellent que derrière de nombreux classements sans suite se cache un système qui a failli.
L’importance de former tous les maillons de la chaîne judiciaire
Un aspect fondamental abordé dans l’ouvrage est le rôle crucial de la formation, non seulement des magistrats et des procureurs, mais aussi des policiers, souvent en première ligne. L’accueil des victimes est déterminant : un mauvais accueil, des remarques déplacées ou une minimisation des faits peuvent dissuader les victimes de poursuivre leur démarche.
Une femme témoigne dans le livre : « Quand j’ai dit que j’avais été violée, le policier m’a demandé pourquoi je n’avais pas crié. J’ai compris à ce moment-là qu’il ne me croyait pas. » Ces attitudes révèlent l’absence de sensibilisation aux mécanismes psychiques du traumatisme, notamment le trouble de stress post-traumatique (TSPT).
Le TSPT, qui touche environ 80 % des victimes de viol, peut provoquer des comportements souvent mal interprétés : confusion, incohérences dans le récit, ou encore dissociation émotionnelle. Ces réactions, loin de discréditer la victime, devraient au contraire alerter les professionnels sur la gravité des violences subies. L’intégration de psychologues dans les parcours judiciaires des victimes de violences est essentielle pour plusieurs raisons. Les psychologues sont formés à reconnaître et à comprendre les mécanismes psychiques complexes qui se mettent en place après un traumatisme, notamment le trouble de stress post-traumatique (TSPT). Leur expertise permet d’éclairer les comportements des victimes, souvent mal interprétés par les professionnels non spécialisés. Par exemple, des récits fragmentés ou incohérents, fréquemment observés chez les victimes de violences, ne traduisent pas un manque de crédibilité mais sont le résultat des processus de dissociation et de gestion cognitive du traumatisme.
Les psychologues jouent également un rôle clé dans l’évaluation de l’impact des violences sur la santé mentale des victimes, en fournissant des rapports médico-psychologiques qui peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans les enquêtes. Par ailleurs, leur présence dès les premières étapes du parcours judiciaire aide à instaurer un climat de confiance et à limiter la revictimisation. En permettant aux victimes de se sentir écoutées et comprises, les psychologues favorisent une meilleure collaboration avec les enquêteurs et le système judiciaire dans son ensemble.
Enfin, intégrer des psychologues dans ces parcours ne bénéficie pas seulement aux victimes, mais également aux autres acteurs de la chaîne judiciaire, en les sensibilisant aux réalités psychologiques des violences subies et en leur offrant des outils pour interpréter avec justesse les réactions des victimes. Cette collaboration interdisciplinaire est indispensable pour garantir un traitement juste, respectueux et efficace des affaires de violences sexistes et sexuelles.
La culture de la « vraie victime » : un stéréotype destructeur
L’un des aspects les plus marquants de Classées sans suite est la mise en lumière du stéréotype de la « vraie victime ». Cette image fantasmée, celle d’une femme vulnérable, effondrée et irréprochable, influence fortement les décisions judiciaires. Les victimes qui ne correspondent pas à ce modèle – parce qu’elles sont calmes, en colère, ou qu’elles ont une vie personnelle jugée « compliquée » – sont souvent considérées comme moins crédibles.
Ce biais est profondément enraciné dans notre culture et alimente une double peine : non seulement la victime doit prouver les violences subies, mais elle doit également démontrer qu’elle est conforme à cette image idéalisée pour être entendue. Ce mécanisme participe à une revictimisation et à une perte de confiance dans le système judiciaire.
L’éducation : une clé pour briser les stéréotypes de genre
Violaine Filippis-Abate souligne que ces biais ne naissent pas dans le vide. Ils s’enracinent dès le plus jeune âge, dans les écoles et les familles. Les rôles genrés, assignés aux filles et aux garçons, perpétuent l’idée que certaines formes de violence ou d’inégalités sont normales.
Les jouets, les livres scolaires, et même les interactions entre enseignants et élèves contribuent à renforcer ces stéréotypes. Une fille qui s’affirme sera souvent qualifiée de « dominante » ou de « difficile », tandis qu’un garçon qui montre des émotions sera moqué. Ces attitudes façonnent des comportements qui, à l’âge adulte, se traduisent par des violences normalisées et une tolérance sociale envers celles-ci.
Des propositions concrètes pour une justice plus efficace
Classées sans suite ne se contente pas de dresser un constat ; l’ouvrage propose aussi des pistes d’amélioration. Voici les recommandations qui m’ont particulièrement marquée :
- Rendre obligatoires des investigations minimales avant tout classement sans suite, en établissant une liste d’actes indispensables, comme l’audition des témoins et l’accès au contenu des téléphones.
- Sanctionner les forces de l’ordre qui ne respectent pas la loi, par exemple en refusant de prendre une plainte ou en tenant des propos déplacés.
- Former les acteurs judiciaires au TSPT pour mieux comprendre les réactions des victimes et éviter les interprétations erronées.
- Rendre certains crimes imprescriptibles (comme c’est déjà le cas dans certains pays), en particulier lorsqu’ils s’agit de viols sur mineurs.
- Mettre en place des juridictions spécialisées, comme cela existe déjà dans d’autres pays, pour traiter exclusivement des violences sexistes et sexuelles.
Ces propositions visent à renforcer la confiance des victimes dans le système judiciaire et à garantir un traitement plus équitable des affaires de violences.
Rappels essentiels pour les victimes
Le livre effectue également des rappels essentiels pour les victimes : il est important de rappeler que le dépôt de plainte est un droit fondamental, et qu’aucun policier n’a le droit de le refuser. Les victimes peuvent également déposer plainte par écrit auprès du procureur de la République.
Le dépôt de plainte doit rester une décision personnelle, guidée par les besoins psychologiques de la victime, et en pleine conscience de la lourdeur du processus judiciaire. Dans un système idéal, où chaque plainte serait traitée avec sérieux, diligence et respect, le dépôt de plainte serait systématiquement conseillé pour garantir justice et reconnaissance. Cependant, en l’état actuel, il est crucial que les victimes soient pleinement informées des défis qu’implique une telle démarche : les longues procédures, la potentielle revictimisation, et souvent le manque de résultats concrets.
Le dépôt de plainte ne doit jamais être imposé ou précipité. La victime doit être prête psychologiquement, avoir conscience des obstacles et surtout, en ressentir le désir. Il n’existe pas de moment prédictible ou universel pour engager cette démarche : chaque personne est différente, et son choix doit s’inscrire dans son propre parcours de reconstruction. Respecter ce rythme individuel, tout en soutenant et en accompagnant les victimes, est fondamental pour éviter d’ajouter de la souffrance à une situation déjà éprouvante.
Conclusion
Je vous propose de terminer cet article par la conclusion du livre :
« Nous avons toutes et tous notre rôle a jouer dans ce combat: en portant attention aux biais ancres dans notre culture pour n’être plus embourbés dans des réflexes sexistes, en éduquant nos enfants dans le respect et légalité pour qu’ elles et ils soient plus libres, en ne laissant passer aucun stéréotype dévalorisant pour que la honte change de camp; et si l’on peut faire plus, en s’engageant au sein d’associations citoyennes, en interpellant sans cesse nos élus sur cette question des violences. Nous sommes au début du réveil judiciaire de la France dans le traitement des violences faites aux femmes. Accompagnons ce moment!
Quittons-nous donc sur les mots puissants de Gisèle Halimi
Il faut une relève à qui tendre le flambeau. Le combat est une dynamique. Si on arrête, on dégringole. Si on arrète, on est foutues. »