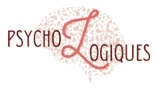Qu’est-ce que l’inversion accusatoire ?
L’inversion accusatoire est un mécanisme de défense ou de manipulation par lequel une personne, plutôt que de répondre aux faits qui lui sont reprochés, retourne l’accusation à l’encontre de son interlocuteur ou d’un tiers. Autrement dit, elle tente de dévier la responsabilité de ses propres actes en attribuant des torts équivalents, voire plus graves, à quelqu’un d’autre. Cette stratégie peut se manifester sous différentes formes : reproches, contre-accusations, attaques personnelles, mise en cause de la légitimité de l’accusateur, etc.
L’inversion accusatoire sert souvent plusieurs intentions à la fois : tout d’abord, elle vise à minimiser ou légitimer son propre comportement en soulignant les fautes, réelles ou supposées, d’autrui afin de relativiser ses propres actes et de les rendre moins graves. Elle a aussi pour objectif de désorienter l’enquêteur ou l’interlocuteur en changeant le sujet ou en remettant en question la légitimité de celui qui accuse, dans l’espoir de gagner du temps ou de déstabiliser la partie adverse. Enfin, elle peut également traduire une forme de projection de la culpabilité, lorsque la personne mise en cause refuse d’assumer ses responsabilités et rejette son malaise ou ses torts sur autrui, se soustrayant ainsi à une remise en question personnelle.
Comment détecter l’inversion accusatoire ?
Un premier indicateur apparaît lorsque se produit un changement brutal de sujet. Concrètement, la personne mise en cause évite de répondre à la question initiale et commence à évoquer des éléments n’ayant pas de lien direct avec le problème soulevé. On remarque alors qu’elle oriente subitement la discussion vers des comportements fautifs (réels ou supposés) de l’enquêteur ou d’autres personnes, y compris le plaignant ou la plaignante. Cette manière de faire vise à semer la confusion et à écarter l’attention des faits qui la concernent. La personne mise en cause peut notamment évoquer des fautes supposées de la personne plaignante, y compris pour des sujets mineurs ou n’ayant pas de rapport avec l’enquête (« le plaignant était en retard dans ses statistiques mensuelles » ; « la plaignante déjeunait dans son bureau alors que c’est interdit »).
Un autre signe distinctif réside dans l’attaque personnelle. Au lieu d’expliquer ou justifier ses propres actes, l’individu remet en cause la compétence ou l’objectivité de l’enquêteur en formulant des critiques directes ou des insinuations. Des remarques telles que « Vous n’êtes pas compétent » cherchent à décrédibiliser celui qui mène l’investigation, plutôt qu’à répondre à la situation examinée.
On observe également une comparaison décalée, où la personne accusée tente de relativiser ses actes en invoquant des situations plus graves. Elle peut alors se défendre en argumentant : « Pourquoi ne vous intéressez-vous pas à tel autre individu, qui a fait bien pire ? » L’enjeu est ici de minimiser ses propres fautes en les comparant à un scénario censé être plus répréhensible, détournant ainsi l’attention de la question de départ.
Enfin, la tonalité défensive ou agressive constitue un autre indice parlant. Le discours devient confus, émaillé d’insinuations, d’allusions vagues et de répliques évasives, ce qui rend difficile toute clarification. Cette forme de communication est souvent accompagnée d’une posture (verbale ou non verbale) indiquant une volonté de « noyer le poisson », empêchant l’enquêteur de recentrer la discussion sur l’objet réel de la plainte ou de l’examen.
Stratégies pour faire face à l’inversion accusatoire et rôle du psychologue
Pour faire face à l’inversion accusatoire, il est essentiel de garder un cap factuel. Cela implique de ramener constamment la discussion vers des éléments concrets et vérifiables, tout en reformulant les propos de l’interlocuteur pour vérifier leur pertinence. Chaque fois qu’une accusation nouvelle émerge, il convient de la noter, mais sans perdre de vue le problème initial pour lequel la personne est interrogée.
Il est également nécessaire de recadrer lorsque la conversation dérive ou lorsque des attaques personnelles surgissent. Rappeler l’objet de l’enquête – par exemple, en soulignant qu’on cherche à comprendre précisément ce qui s’est passé à une date ou autour d’un fait donné – aide à maintenir le débat dans un cadre constructif.
Par ailleurs, un climat de sécurité doit être établi pour favoriser une expression libre et sincère. Il est utile d’insister sur la confidentialité de l’enquête et la neutralité de la démarche. Sur le plan pratique, il convient de structurer l’entretien en progressant étape par étape. En cas de digression, l’enquêteur peut interrompre poliment pour ramener la discussion au point de départ et éviter que le dialogue ne se perde dans des détails superflus.
Enfin, il ne faut pas négliger le contexte émotionnel. Être accusé peut générer une forte pression ou un sentiment d’injustice, et il est important de reconnaître ces émotions, voire de faire preuve d’empathie. Cependant, la fermeté dans la recherche des faits demeure primordiale : « Je comprends votre inquiétude, mais nous devons clarifier la situation qui vous concerne » est un exemple de réponse équilibrée qui tient compte du ressenti de l’interlocuteur sans renoncer à l’objectif de l’enquête.
Dans ce cadre, le rôle du psychologue s’avère particulièrement précieux. Un enquêteur formé en psychologie peut identifier plus rapidement les signaux de stress, d’évitement ou de manipulation (tels que les tics verbaux, l’agressivité ou le refus de répondre). De plus, ces professionnels ont l’habitude de gérer la dimension émotionnelle, permettant à la personne mise en cause de s’exprimer sans jugement, tout en la confrontant aux faits de manière impartiale. Leur posture de tiers neutre renforce non seulement la crédibilité de la procédure, mais aussi la coopération des différentes parties, qui se sentent davantage en confiance pour livrer une version des faits authentique et détaillée. Enfin, maîtriser ces mécanismes demeure essentiel pour mener une enquête objective et ne pas se laisser distraire ni manipuler par des manœuvres visant à détourner l’attention des faits.